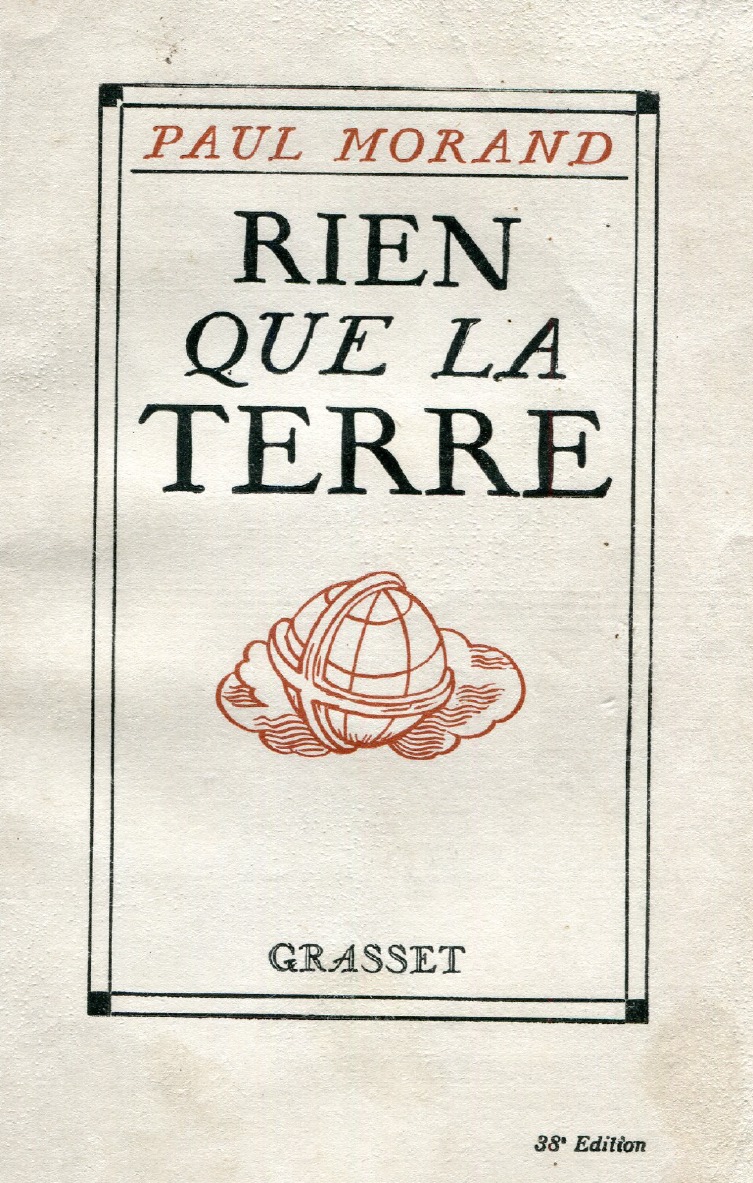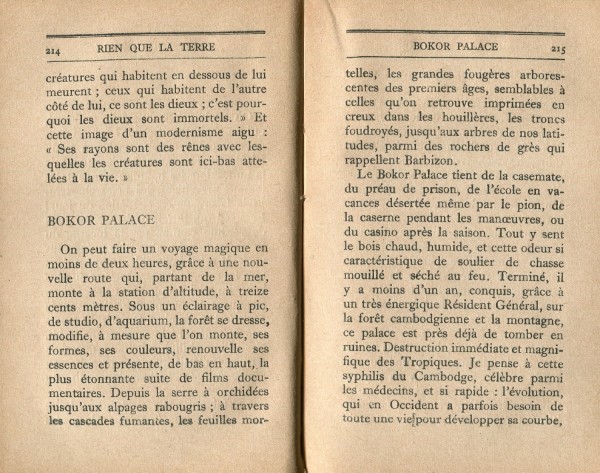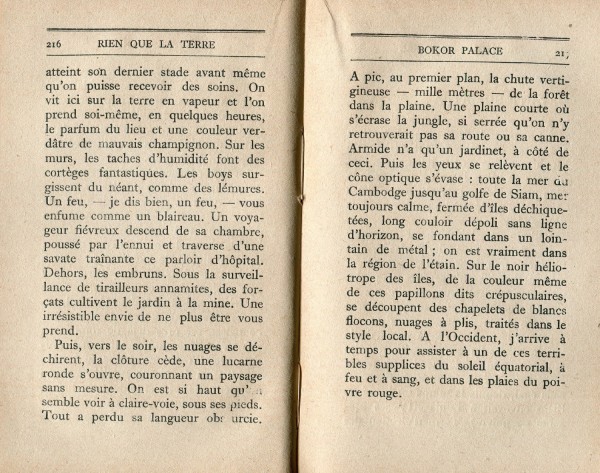BOKOR PALACE
On peut faire un voyage magique en moins de deux heures, grâce à une nouvelle route qui, partant de la mer, monte à la station d’altitude, à treize cents mètres.
Sous un éclairage à pic, de studio, d’aquarium, la forêt se dresse, modifie, à mesure que l’on monte, ses formes, ses couleurs, renouvelle ses essences et présente, de bas en haut la plus étonnante suite de films documentaires. Depuis la serre à orchidées jusqu’aux alpages rabougris; à travers les cascades fumantes, les feuilles mortelles, les grandes fougères arborescentes des premiers âges, semblables à celles qu’on retrouve imprimées en creux dans les houillères, les troncs foudroyés, jusqu’aux arbres de nos latitudes, parmi des rochers de grès qui rappellent Barbizon.
Le Bokor Palace tient de la casemate du préau de prison, de l’école en vacances désertée même par le pion, de la caserne pendant les manœuvres ou du casino après la saison.
Tout y sent le bois chaud, humide, et cette odeur si caractéristique de soulier de chasse mouillé et séché au feu. Terminé, il y a moins d’un an, conquis, grâce à un très énergique Résident Général, sur la forêt cambodgienne et la montagne, ce palace est près déjà de tomber en ruines. Destruction immédiate et magnifique des Tropiques. Je pense à cette syphilis du Cambodge, célèbre parmi les. médecins, et si rapide: l’évolution, qui en Occident a parfois besoin de toute une vie pour développer sa courbe, atteint son dernier stade avant même qu’on puisse recevoir des soins.
On vit ici sur la terre en vapeur et l’on prend soi-même, en quelques heures, le parfum du lieu et une couleur verdâtre de mauvais champignon.
Sur les murs, les taches d’humidité font des cortèges fantastiques. Les boys surgissent du néant, comme des lémures. Un feu, — je dis bien, un feu—, vous enfume comme un blaireau. Un voyageur fiévreux descend de sa chambre, poussé par l’ennui et traverse d’une savate traînante ce parloir d’hôpital. Dehors, les embruns. Sous la surveillance de tirailleurs annamites, des forçats cultivent le jardin à la mine.
Une irrésistible envie de ne plus être vous prend.
Puis, vers le soir, les nuages se déchirent, la clôture cède, une lucarne ronde s’ouvre, couronnant un paysage sans mesure. On est si haut qu’on semble voir à claire-voie, sous ses pieds. Tout a perdu sa langueur obscurcie. A pic, au premier plan, la chute vertigineuse —mille mètres— de la forêt dans la plaine. Une plaine courte où s’écrase la jungle, si serrée qu’on n’y retrouverait pas sa route ou sa canne. Armide n’a qu’un jardinet, à côté de ceci.
Puis les yeux se relèvent et le cône optique s’évase: toute la mer du Cambodge jusqu’au golfe de Siam, mer toujours calme, fermée d’îles déchiquetées, long couloir dépoli sans ligne d’horizon, se fondant dans un lointain de métal.
On est vraiment dans la région de l’étain. Sur le noir héliotrope des îles, de la couleur même de ces papillons dits crépusculaires, se découpent des chapelets de blancs flocons, nuages à plis, traités dans le style local. A l’Occident, j’arrive à temps pour assister à un ,de ces terribles supplices du soleil équatorial, à feu et à sang, et dans les plaies du poivre rouge.
—

Paul Morand vers 1925
Paul Morand
Rien que la Terre. Grasset, 38° Edition, p. 214